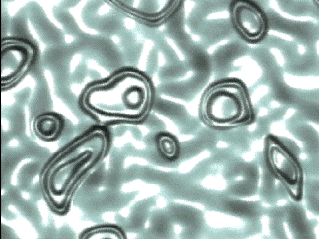 |
De la
construction du sensible à la Note à partir de L'Architecture de verre, de Paul Scheerbart |
...Ce projet tombé dans l'oubli, nous pouvons avoir l'impression, en déambulant dans les espaces urbains qui nous environnent, qu'il s'est trouvé finalement réalisé... |
Le Corbusier date de 1914 la naissance
de la grande ville, cette réalité nouvelle qui sera le
siège des rêves et des catastrophes du siècle. Et qui
s'édifie avec les moyens de l'industrie militaire rendus
vacants par la fin de la guerre 1914, c'est aussi
l'année où Paul Scheerbart écrit L'architecture de
verre (publié en français chez Circé). Projet détaillé de l'utopie technique et sociale d'une architecture utilisant les nouveaux procédés de construction à faible coût (structures portantes métalliques, murs-rideaux de verre, etc...) qui auraient dû à ses yeux pouvoir changer la vie des hommes. Ce projet tombé dans l'oubli, nous pouvons avoir l'impression, en déambulant dans les espaces urbains qui nous environnent, qu'il s'est trouvé finalement réalisé dans les immenses immeubles aux façades réfléchissantes partout présents. C'est Jean Nouvel qui le dit : notre milieu urbain est un " univers de construction de l'illusion, où l'esthétique, changeante, est faite de reflets, de lectures de plusieurs trames immatérielles, où toute la perception de l'image est programmée en un sens aléatoire, non pas techniquement mais dans l'ordre du sensible... ". La ville comme jeu d'effets visuels programmés, image où nous nous mouvons, images à notre tour. |
| Pour Scheerbart, l'ordre du sensible,
ce n'était pas d'abord l'ordre du visible mais celui du
photo-sensible, de la sensibilité à la lumière; le
verre devait être coloré afin de révéler pleinement
le phénomène lumineux. Peu importe si le projet de
Scheerbart était ou non
" réalisable " (à ses yeux, il
était très réaliste), et l'on pourrait discuter à
l'infini pour savoir s'il aurait été à même de rendre
la vie des hommes plus belle. On pourrait même lui
reprocher de n'avoir visé qu'à embellir extérieurement
cette vie, sans rien changer aux rapports sociaux qui
pouvaient bien perdurer inchangés, chacun derrière ses
vitres colorées. La question n'est pas là. La question est plutôt de savoir ce que peut bien signifier " l'ordre du sensible " et d'essayer de prendre au sérieux cette idée que nous sommes des êtres qui sentent. Si la modernité c'est seulement l'accent mis sur les " nouveaux " matériaux et l'injonction à révolutionner les techniques de construction, alors notre âge est résolument moderne. Mais alors, Scheerbart n'était pas seulement un " moderne ". Car il est un de ceux qui ont essayé de faire face par son projet à ce que Walter Benjamin appelait la " nouvelle pauvreté " de l'expérience après la guerre, dont témoignait à ses yeux le mutisme de ceux qui revenaient des tranchées " non pas plus riches mais plus pauvres en expérience communicable ". L'architecture de verre : projet d'une architecture qui ne nourrit aucune nostalgie à l'égard de la richesse passée, du temps de l'intérieur bourgeois comme espace qui recueille les traces d'une identité, d'une vie privée, protégée, bien à soi. A propos du projet de Scheerbart,
Benjamin écrit : " Le verre n'est pas pour
rien un matériau si dur et lisse, sur lequel rien ne
s'accroche. [...] Le verre en général est l'ennemi du
secret. Il est aussi l'ennemi de la
possession ". Et ainsi, dans l'architecture, il
peut être question d'une transformation de nos valeurs. |